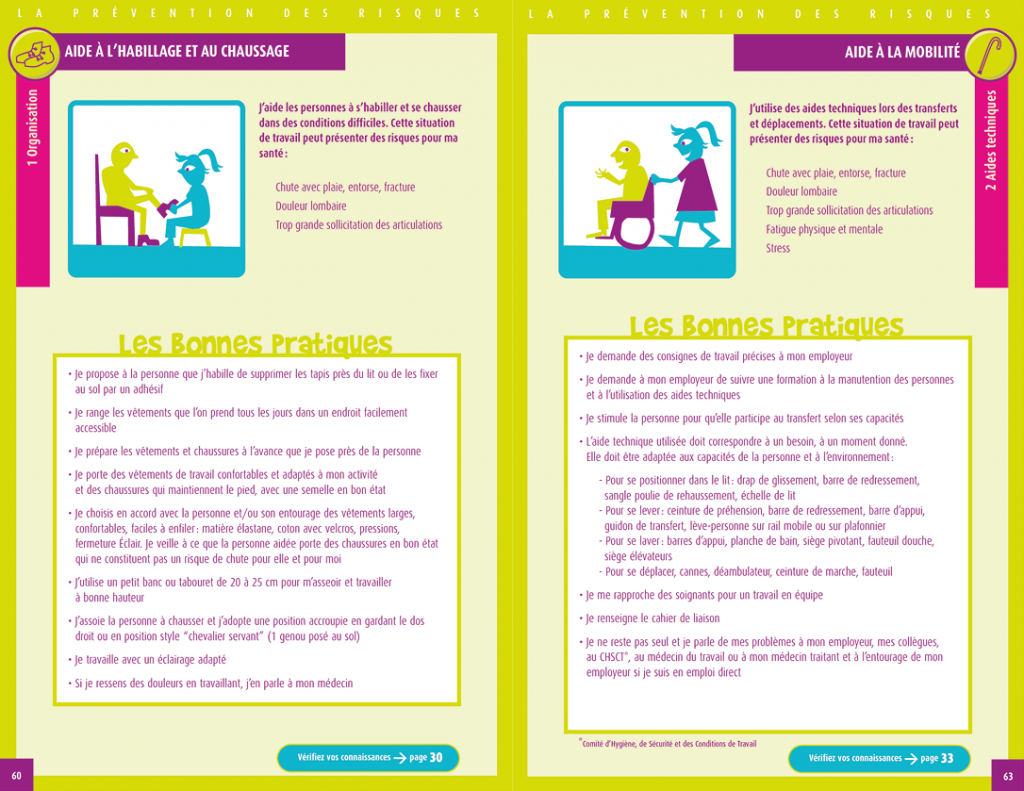Pourquoi ce guide ?
Du ménage à la préparation des repas, en passant par l’aide aux démarches administratives, l’aide à domicile apporte son soutien pratique et moral aux personnes qui en ont besoin à leur domicile.
Ces métiers apportent le plus souvent beaucoup de satisfactions aux professionnels qui l’exercent. Néanmoins ils les exposent au risque d’accidents du travail et de maladies professionnelles davantage que l’ensemble des salariés du régime
général.
Ce guide des bonnes pratiques est destiné aux intervenants de terrain. Il peut être utile pour les situations suivantes :
• pour l’accueil d’un nouvel embauché
• lors de réunions internes sur le thème de la prévention des risques professionnels animées par l’encadrement ou des préventeurs
• pour le renfort des actions de tutorat et de marrainage
Le quizz
La première partie du guide est consacrée à un jeu de questions-réponses autour de la prévention des risques professionnels. Il vous est proposé de tester vos connaissances en choisissant des situations parmi 12 thèmes : nettoyage et rangement, entretien du linge, des sanitaires, aide à la prise des repas …
Des séries de questions vous permettent d’évaluer votre profil : débutant, averti ou expert. Certaines réponses vous paraîtront peut être trop simples, d’autres vous feront sourire. C’est un des principes qui a été retenu : apprendre en s’amusant.
Les bonnes pratiques
La seconde partie contient un ensemble de bonnes pratiques qui s’appliquent sur le terrain pour protéger la santé des intervenants.
Des médecins et des professionnels ont contribué à la rédaction de ces recommandations.
Il n’y a pas de règle imposée. Choisissez un thème et découvrez les informations proposées.
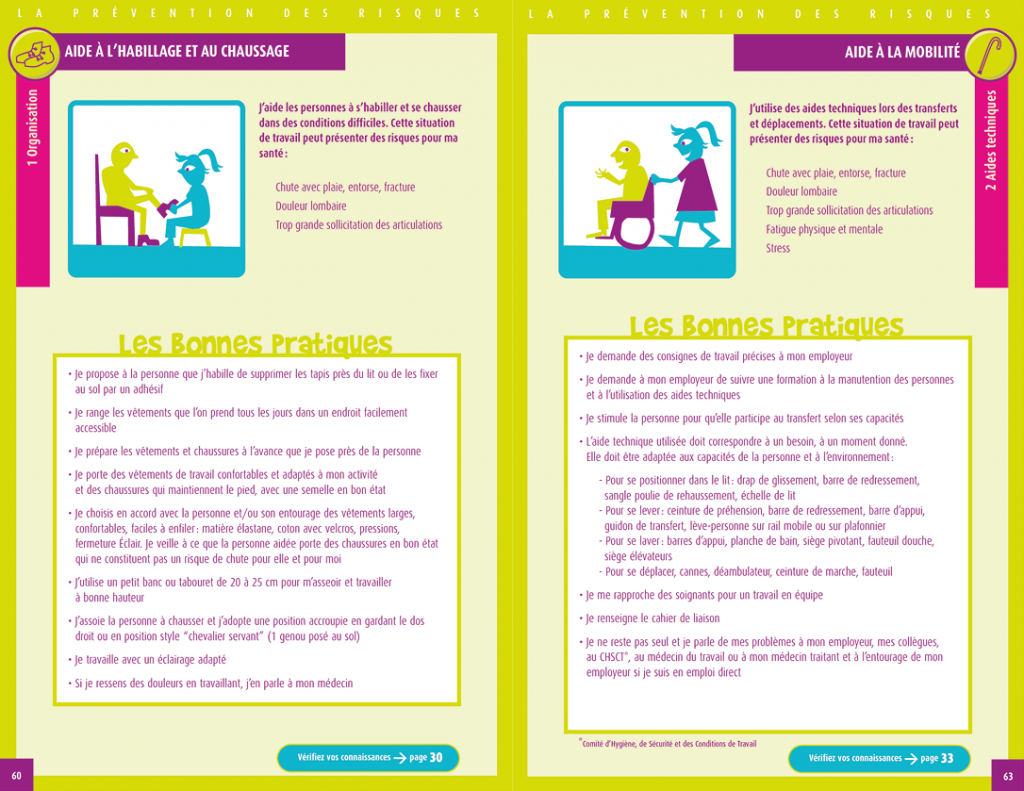
Télécharger le livret